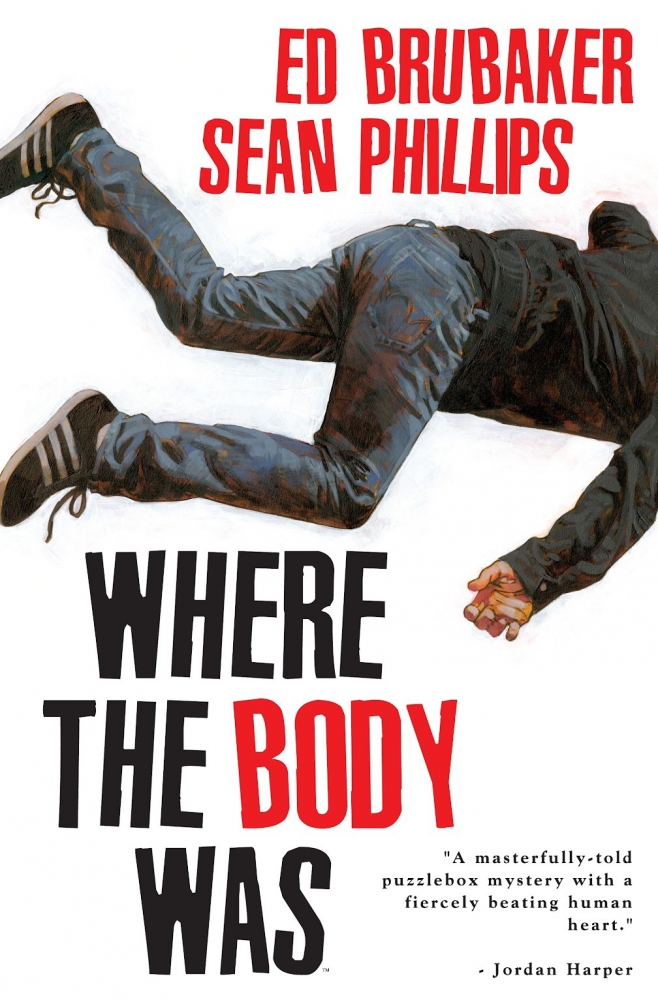Bienvenue dans un nouveau numéro de la chronique des "critiques express". A intervalles réguliers, la rédaction vous propose de courtes reviews sur des numéros de comics VO sortis récemment. L'idée est de pouvoir à la fois vous proposer une analyse des sorties attendues du côté des éditeurs mainstream et indé', parler également de runs sur la durée, et essayer de piquer votre curiosité sur quelques titres moins en vue. En somme, tout simplement de mettre en avant le médium comics dans nos colonnes autrement que par le prisme pur de l'article d'actualités.
Noël, c'est terminé. Et alors que s'entame une nouvelle course folle, pour savoir qui attendra le plus longtemps avant de débarrasser le sapin du salon (oui c'est de toi qu'on parle, là, dans le fond), la rotation perpétuelle des sorties de comics poursuit son infatigable marche forcée. Quelque part, cette routine a quelque chose de rassurant. Les fêtes passent, mais les comics restent. Et si le couple mardi/mercredi de cette semaine a pu correspondre, pour le gros du public, aux valises, aux parties de scrabble avec les grands-parents et à la cuisson des restes de dinde aux marrons dans la graisse de canard (beau-papa en raffole), pour l'industrie de la BD américaine, il était surtout question d'étoiles de mer géantes et d'allégories sociales associant un peuple fictif de guerrières grecques à la lutte des nations occidentales contre les fameux ennemis de l'intérieur. Bref, une routine contre une routine. Les deux n'ont pas forcément vocation à se croiser.
C'est même tout l'intérêt : dans un monde en proie au chaos, la culture reste l'une des dernières zones de refuge. Pour réfléchir, apprécier, voyager, s'évader éventuellement. Le rendez-vous hebdomadaire des sorties VO passe pour une aire de repos bienvenue au sortir d'une année compliquée, dans la mesure où Noël ne dure que deux jours et que tout le monde n'a pas le temps de prendre trois heures dans une semaine pour aller au cinéma. Alors, on apprécie de lire, surtout quand les éditeurs font le boulot correctement. Une chance : cette petite passe bimensuelle a tenu la consigne, avec pas mal de sorties intéressantes, sans même avoir besoin de s'accrocher aux super-héros. Et pour guérir de la gueule de bois champagne, vin chaud et digestif des fêtes, pourquoi ne pas commencer par passer à la DSTLRY ?

Avec ce dernier numéro, Tom King plie un nouvel album à ajouter à la pile. Un album qui résume assez bien les forces du scénariste... et ses principales faiblesses par la même occasion. Tout le problème est là : plus King progresse, plus la signature King se charge d'une sorte de promesse inamovible. Ce qui est vrai pour tous les auteurs qui réussissent à faire leur trou. Si l'on va lire un comics de Scott Snyder, par exemple, on peut s'attendre à un medley de deux imaginaires empilés l'un sur l'autre, à des explications verbeuses, à une mythologie installée en surplomb. Si l'on va lire du Garth Ennis, on doit s'attendre à un humour de sale gosse, à un peu de violence, ou à un grand respect pour la question militaire. Etc. N'importe quel scénariste qui enchaîne les projets au point d'en avoir suffisamment pour que le lecteur note les ressemblances entre les uns et les autres finit par avoir entre les pattes un stock à la fois fascinant et gênant - à savoir, une œuvre, plus qu'une simple bibliographie.
Or, Danger Street est un titre intéressant, parce qu'il se présente justement comme une photographie de l'oeuvre complète de Tom King à un moment T. Avec cette maxi' en douze, le scénariste est parti d'un postulat intéressant : prendre des personnages très anciens, très oubliés, pour les rassembler dans un polar sérieux, réaliste, très ancré dans le sol, et dans cette perspective humaine qui vise à casser les codes du super-héros de "compression", premier degré, pour associer ces grandes figures à des archétypes plus réalistes. En somme, cette formule qui avait commencé à prendre forme avec Vision, magnifiée dans Mister Miracle, et devenue depuis son modèle de routine. Danger Street est, dans ce sens, un exercice réussi. Ces personnages (que le public moderne connaît assez mal, voire ne connaît pas du tout), sonnent vrai. Humains. Incarnés. Les uns et les autres s'emboîtent parfaitement dans une histoire chorale qui emprunte au cinéma du polar-labyrinthe tragicomique (les destins croisés de truands ou d'ordures dans une perspective caustique où les personnages se croisent, s'entretuent, se loupent - pensez à Fargo, pensez à Pulp Fiction, pensez à Snatch, etc).
King va aussi mettre dans cette histoire des référents politiques intéressants (avec le Creeper, avec la Green Team), un propos sur l'enfance plutôt inattendu (les Dingbats, les Outsiders), en tapissant cet environnement d'un désespoir palpable pour ces humains de rien du tout qui vivent dans les Etats-Unis de la périphérie. Là où les grands super-héros ne viennent jamais rendre la justice, là où l'image de Superman, l'avatar même de la nation, ne répond pas quand on tente de le contacter. Le Manhunter ou Codename : Assassin passent pour de superbes hommage au mythe du tueur froid en fiction, le scénario est bien gratté dans son jeu d'allers et retours, et l'allégorie d'une histoire présentée comme un conte de fée est intelligemment construite. Quelques passages sont même touchants, et on aurait envie de voir le titre comme un bout canonique du "King-Verse" avec cette parabole sur les New Gods pensée comme un hommage frontal à The Killing Joke et où Orion devient le raté alcoolo' qui n'a pas su aller aussi loin que Scott Free dans la maxi' Mister Miracle. Bien sûr, Jorge Fornes livre une partition sans faute, avec ces structures corporelles réalistes, cet encrage épais et cette science de la digestion des costumes "Silver Age" dans une sauce crédible qui donne toute sa saveur au décalage ironique entre la matérialité absurde des comics et le monde réel.
Mais alors, les défauts ? Il sont là, ne vous inquiétez pas. Et ils sont nombreux. Tom King n'a eu de cesse de le dire : si le bonhomme officie encore chez DC Comics, c'est que l'éditeur lui laisse pas mal de liberté. Trop de liberté. Le rythme est chaotique dans cette histoire en douze numéros qui pourrait tenir sur huit ou sur dix. Les passages sur les Dingbats deviennent assez rapidement des séquences dispensables, qu'on lit en diagonale en attendant que l'intrigue progresse. La série est trop bavarde, avec trop de séquences qui s'oublient, qui ne servent qu'à occuper l'espace, prétextes à des évolutions de personnages très prévisibles, et très implicites, dont on se serait bien passé. Il en ressort un comics parfois brillant, et parfois lourd, pesant, que l'on aborde comme un chemin de croix sur certains numéros en essayant péniblement de terminer une scène où les personnages causent pour ne rien dire. Mention spéciale au duel entre Manhunter et Codename : Assassin, qui représente à lui seul une bonne heure de lecture, et où King semble chercher à imposer un duel philosophique au lecteur pour tordre le cou à l'idée d'une bataille virile entre deux super-meurtriers. L'intention est louable, mais le résultat est... terriblement pompeux et contre-productif.
De la même façon, cette obsession du scénariste pour les personnages qui ne parlent qu'en gros mot, dans un monde où DC Comics va forcément censurer le moindre "fuck" ou le moindre "shit" pose un problème de lecture quand des scènes entières se résument à déchiffrer les caractères d'imprimerie qu'on met à la place des "bips" dans ce genre de cas de figure. La fin est aussi discutable, mais encore une fois, Tom King n'est pas connu pour les conclusions rationnelles. Dans Killing Time, on nous explique que le vilain voulait... tuer le temps. Dans Danger Street, on va nous dire que l'origine même de l'artefact qui motive toute l'intrigue... ne sera pas expliquée. Dans le One Bad Day : The Riddler, le vilain annonce qu'il n'y avait pas vraiment d'énigme cette fois ci, qu'il s'agissait plutôt d'un avertissement.
En somme, le scénariste aime jouer avec cette idée de la quête de sens inassouvie, d'une alternance dans la recherche qui voudrait proposer des histoires dans un vide thématique, où le parcours des personnages lui-même finit par devenir le motif, sans avoir besoin de mettre une "réponse" ou une "résolution" factice au bout du chemin. Une approche tentante, dans un monde où les significations profondes paraissent de plus en plus floues à mesure que notre rapport au réel évolue (et aussi parce que l'écriture en "twist" commence à devenir ringarde - là-encore, voir ce que Scott Snyder propose sur le même sujet). Et puis, quitte à rendre hommage à Tarantino ou aux frères Coen, une histoire qui se boucle sans réponse nette, sans que le public appréhende le contenu de la mallette, ou que Llewyn Davis n'accomplisse quoi que ce soit, a quelque chose de cohérent. Mais cette fois, la pirouette existentialiste a un peu de mal à passer. Peut-être parce que Danger Street n'est pas une histoire existentialiste, et que les contes de fée ont toujours besoin d'un peu plus de background pour faire croire à leur petite thèse du merveilleux. Dommage. Mais dans l'ensemble, une lecture qui reste forte, à défaut d'être capable de fédérer.
Et c'est malheureusement le bilan qui risque de s'imposer pour les années à venir. La balance de l'équilibre qualités et défauts va surtout se mesurer à l'envie que l'on peut avoir de plonger dans l'esprit d'un auteur qui aborde systématiquement les choses sous le même plan, en variant le sujet, la formule ou la relation aux dessins en fonction de ses humeurs. Danger Street est un exercice très intéressant, et une série qui change, dans le paysage des super-héros, au point de donner envie d'aller découvrir tous ces obscurs personnages des années soixante-dix, ou d'espérer une suite pour accompagner certains d'entre eux un peu plus loin. Mais le titre reste plus faible que Human Target ou Mister Miracle. Peut-être plus proche de Strange Adventures dans son incapacité à justifier un rythme souvent éreintant, ou dans cet exercice de style poussé à l'extrême au point de perdre de vue ce pourquoi on était, au départ, monté à bord de la série. Au global, et peut-être aussi parce que le scénariste n'est plus capable de retenir ses pensées philosophiques du moment, on sort de cette série sans savoir exactement quoi en faire. Ni un blockbuster, ni un divertissement, ni un hommage, ni une déconstruction, ni un manifeste politique, Danger Street fait beaucoup de choses à la fois sans réussir à se situer sur une promesse tangible. Une toile abstraite intéressante peuplée de couleurs, de tonalités et de notes de goût saisissantes, avec de superbes idées, et de superbes coups manqués. Bref, un bordel joyeux, ou un joyeux bordel. A vous de voir.
Vous pouvez commander Danger Street #12 à ce lien !

Un peu plus tôt dans l'année, DSTLRY attaquait les hostilités sur le marché de l'indépendant avec Gone, première de leur proposition après l'anthologie The Devil's Cut #1. Sur le papier, un ensemble de raisons pour se réjouir : Jock opère au scénario et au dessin pour ce récit de science-fiction dans lequel de jeunes gamins tentent de piller d'immenses cargos tenus par la méga-corporation qui tient la galaxie entre ses mains. Au cours d'une de ces opérations, le jeune Abi reste coincé dans l'un de ces immenses vaisseaux et tente de survivre en compagnie d'autres clandestins. Si Abi est résolu plus que tout à retrouver les siens, il semble que les autres personnes embarquées n'ont pas les mêmes objectifs. Les petits contre les puissants : la thématique n'a rien de neuf dans la SF, et Jock déçoit un peu pour l'ouverture de son premier creator-owned en solo. On fait peut-être la fine bouche. D'un point de vue visuel, le dessinateur n'a rien perdu de sa superbe, ni dans son style au trait cassé, ni dans son imaginaire (quels superbes vaisseaux), et se montre efficace dans sa mise en scène, particulièrement avec ses double-pages. Il faut dire que le format agrandi des comics DSTLRY est bien pensé pour que les artistes se fassent plaisir, et son lectorat aussi.
Malgré le nom de Jock au dessin, il faudrait que Jock au scénario soit de la même trempe. Pour l'instant, Gone #1 se montre encore trop léger et n'arrive pas vraiment à dépasser sa dimension introductive, malgré plusieurs ellipses temporelles. On n'ira pas à dire qu'on peine à s'intéresser au devenir d'Abi, mais il y a un sentiment de déjà-vu pour qui a déjà lu/regardé des oeuvres de science-fiction, sans qu'un élément qui viendrait faire la différence ne se montre encore pour le moment. Le scénario laisse toutefois assez de zones d'ombre pour qu'on ait envie de poursuivre la lecture, mais on se retrouve à devoir attendre jusqu'à fin janvier 2024 pour cela - alors qu'au sortir de ce premier numéro, la publication était annoncée pour ce mois-ci.
Gone se retrouvera typiquement dans le cadre du quitte ou double sur son second chapitre, et on aurait aimé être conquis immédiatement. Ce premier numéro a bien évidemment de nombreuses qualités pour lui, particulièrement sur le plan visuel. Mais l'histoire ne se montre pas si intéressante que ça, quand bien même l'univers développé par Jock ne demande qu'à être exploré. C'est frustrant, voilà tout, il faudra faire avec.
- Vous pouvez commander Gone #1 à ce lien !
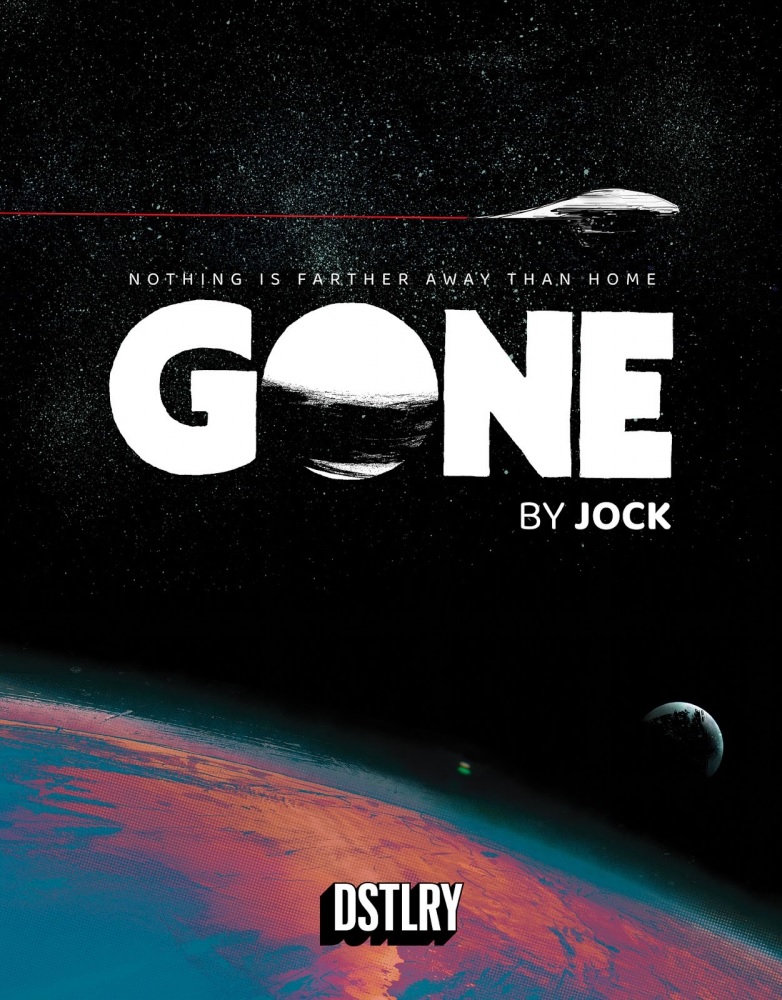
Autre nouveauté, autre grand habitué, Brian Bendis est de retour. Avec une nouvelle création originale. Encore ? Oui, encore. Mais le terme est probablement galvaudé à ce stade de sa carrière. Dans les faits, Masterpiece est effectivement une nouvelle histoire. Mais le scénariste commence à avoir suffisamment de boue sous les bottes pour que le public commence globalement à comprendre les rouages, la construction et le style. En somme, Masterpiece pourrait tout aussi bien s'appeler "Scarlett (mais cette fois, c'est la fille d'un couple de cambrioleurs) #1" ou "Pearl (mais cette fois, c'est Maleev aux dessins) #1" sans avoir besoin d'une description plus honnête. Oui, Bendis se répète. Est-ce que c'est grave ? Non, puisque son lectorat sait à quoi s'en tenir. Est-ce que c'est dommage ? Non plus, parce que le mieux est l'ennemi du bien.
Plongez, donc, dans cette énième variation sur l'histoire d'une adolescente à grande gueule qui se prépare à pénétrer dans un autre monde, face à cette énième variation sur la vieille fripouille qui représente l'homme de pouvoir d'autrefois. Masterpiece est l'histoire de la jeune Emma, une orpheline élevée par sa tante qui n'a jamais connu ses parents biologiques. Emma est intelligente, talentueuse, prometteuse, et son patrimoine génétique n'y est peut-être pas pour rien. Un beau matin, l'héroïne va être arrachée à sa salle de classe par deux brigands qui se font passer par des agents fédéraux. Elle est amenée devant un certain Stan Lee - pardon, un certain "Zero Preston", un vieux milliardaire avec une main dans les milieux illicites. Celui-ci lui explique que ses parents étaient en réalité des cambrioleurs de haut vol. Des légendes du milieu. Des artistes, des aristocrates du braquage organisé. Les deux géniteurs de l'héroïne ont subtilisé des millions de dollars à Zero, et celui-ci compte bien exploiter la jeune femme pour se rembourser, d'une façon ou d'une autre. Voilà le décor.
Comme d'habitude avec les séries de la maison Brian Bendis : tout passe par le dialogue. Ca vanne, les répliques s'entrechoquent, les bulles suivent une élégante trajectoire pour formuler le sens de lecture et le débit de parole de chaque personnage. Le texte opère dans les codes du cool à l'ancienne, à la Shane Black, à la Aaron Sorkin... à la Bendis. Et comme d'habitude, des personnages en forme d'archétype vont s'amuser à critique leurs propres archétypes. Tout va vite, l'installation ne perd pas de temps, on évacue les questions gênantes ou l'envie de poser un contexte plus riche, l'atmosphère respire le cinéma de commande d'antan et la cabriole américaine de genre - en gros, dites vous que Mr et Mrs Smith ont eu une fille, que le méchant des Ocean's Eleven lui a mis le grapin dessus, et que la structure va jouer les Harry Potter ou les Percy Jackson réalistes avec cette idée de l'enfant qui ne savait pas et qui pénètre gentiment dans un nouvel univers. Pensez aussi à Wanted, ou à Kingsman. Pensez à plein de choses, au final. Rien de tout ça n'est très nouveau. C'est juste cool. Parce que Bendis écrit dans les codes du cool, peu importent les circonstances ou le présupposé.
Au final, un constat agréable - pour une certaine démographie du lectorat. Celles et ceux qui aiment ce style, ou qui regrettent peut-être cette bonne période où le scénariste, en compagnie de ses clones, de ses élèves ou de ses rivaux, dominaient le marché des comics de la tête et des épaules avec des propositions inspirées par Hollywood, pensées comme des séries télévisées, et déclinées à l'envie jusqu'à épuisement des stocks. La perspective d'une série de braquage par Bendis est forcément l'assurance d'une régalade en perspective pour cette part du public, et avec le Maleev retrouvé, la promesse d'un peu de nostalgie pour celles et ceux qui auraient commencé la BD par Daredevil, les combats de yakuza et les amourettes du Murdock d'antan.
Premier numéro extrêmement léger, avec peu de choses à se mettre sous la dent, sinon cette même impression familière. Comme d'habitude, Bendis fait du Bendis, et malgré son âge, son genre et l'épaisseur de son compte en banque, l'auteur n'a rien perdu de son talent pour écrire de jeunes ado' rebelles dans un monde d'adulte obsédé par les mêmes choses. On se laisse tenter, tout en comprenant que le projet reste une nouvelle déclinaison dans un modèle que l'on a déjà eu le temps de lire, de comprendre et de digérer, simplement parce que le scénariste n'a rien perdu de son talent et qu'on retourne dans le moule comme dans une solide paire de charentaises. Même constat pour Alex Maleev, d'ailleurs. Sans jamais chercher à se réinventer, l'artiste appose les mêmes structures corporelles, les mêmes champs contrechamps, le même esprit urbain des grandes villes américaines, des adolescentes de fiction, des riches méchants de fiction, pour une série qui aurait pu sortir il y a quinze ans chez Icon avec les mêmes ingrédients et la même première impression. C'est bon de savoir qu'il existe des valeurs refuges, dans un monde en mouvement. Au fond, pourquoi vouloir changer une équipe qui gagne ?
- Vous pouvez commander Masterpiece #1 à ce lien !

Un roman graphique dans cette chronique généralement consacrée aux formats singles ? Pourquoi pas. L'objectif est d'abord de parler de ce qui se passe en VO après tout, et le moindre nouvel album d'Ed Brubaker et Sean Phillips est toujours un événement pour le marché indépendant. Et aussi, après avoir fouillé consciencieusement les nouveautés Marvel, pour tout vous dire, on n'a pas forcément trouvé grand chose de franchement engageant. Difficile de justifier de canarder l'ambulance pendant la période des fêtes (même si Christos Gage et Greg Land avaient visiblement envie de tendre une perche aux critiques avec leur gag de la fin d'année, Original X-Men, une escroquerie en bande organisée comme on en fait plus - merci pour la blague, c'est sympa de faire rire les copains, bel esprit de Noël, bravo).
Brubaker et Phillips poursuivent donc leur série de romans graphiques solitaires, après quelques années passées à explorer la Californie des années quatre-vingt en compagnie d'Ethan Reckless. Cette fois, l'album s'appelle Where the Body Was, et celui-ci a été conçu comme l'étude d'un souvenir très personnel pour le scénariste. Le quartier, la rue de cette petite aventure, sont calqués sur un environnement que Brubaker connaît. Où il a grandi. Ces personnages, quoique romancés, sont basés sur des figures bien réelles de son adolescence. Et si, comme d'habitude, l'ingrédient secret reste le crime, l'anecdote qui sous-tend toute l'intrigue est apparemment inspirée de faits réels. En somme, Ed Brubaker est parti à la pêche aux souvenirs pour cette dernière création originale, et le résultat est... étonnamment contrasté. Where the Body Was ne reproduit pas la prouesse de Night Fever, ou des Reckless. Et l'auteur sera le premier à l'admettre (dans la postface qui clôt l'album) : cette histoire est un peu différente des autres.
Le titre marche sur un principe de témoignages enchâssés. Plusieurs personnages gravitent dans un même quartier, au sein d'une banlieue résidentielle sans histoire. Les points de vue s'enchaînent les uns à la suite des autres, chacun développe sur son petit quotidien, son rapport aux autres, sont rapport à la vie. Le scénario installe l'idée générale que cette petite recomposition s'articule autour d'un crime commis à une certaine époque. En somme, comme un documentaire sur une affaire sordide, où une équipe se serait déplacée après les faits. Les différents profils sont tous plutôt intéressants, plutôt marqués, uniques, avec leurs propres voix, leurs propres identités. L'idée de cette petite banlieue remplie d'individualités au carrefour les uns des autres s'anime avec élégance, et une certaine poésie dans ce rapport au réel. Cette fois, Brubaker creuse cet élément, généralement inscrit dans le substrat de ses meilleures histoires : tout ceci est vrai, ou suffisamment vrai pour lui permettre de brosser un portrait sur l'existence, par-delà les échanges de cartouches, les femmes fatales et les rixes de truands.
Cette écriture plus dépouillée, plus écorchée vive, accompagne le scénariste depuis la sortie de l'album My Heroes Have Always Been Junkies. Une sorte de deuxième vague dans la carrière de Brubaker, qui abandonne peu à peu les éléments de fiction au profit de l'étude de profils plus complexes. Les premiers albums de Criminal évoquaient les destins croisés de gangsters faillibles, et déjà très complets, mais qui s'inscrivaient dans un maillage scénaristique où l'objectif était d'abord de résoudre quelque chose de très concret. Plus tard, Brubaker a commencé à inverser la tendance, en se concentrant sur la partie existentielle, émotionnelle de ses héros, au point de faire passer le scénario proprement dit, le crime, le polar, au second plan. Reckless était peut-être la dernière "série" à chercher un équilibre entre ces deux éléments. D'un côté, une narration interne qui étudie la vie d'un homme (qui vient de perdre son père) dans son rapport aux autres, à la solitude, à la société américaine, aux loisirs et au temps qui passe, et de l'autre, les enquêtes, les nazis, les secrets du Hollywood des hippies, etc. Where the Body Was, comme My Heroes, choisit de se focaliser sur l'humain. Le crime est au second plan. Ou au troisième. Ou au quatrième.
Cette collection de destins groupés dans une intersection va même être traitée comme un élément bien plus naturaliste. Brubaker s'autorise à aller de l'avant, à reprendre ces mêmes personnages plus loin, plus tard. A les confronter, à mots couverts, aux vicissitudes de la vie. Un jeune junkie qui croit être le héros de l'histoire, l'amoureux transit qui va explorer les Etats-Unis avec sa copine fugueuse, réalise bien plus tard qu'il n'était qu'un gamin idiot lorsque, beaucoup plus tard, il découvre quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. De beaucoup plus réel. Voilà où Brubaker veut nous emmener dans Where the Body Was. Le scénariste, lui-même arrivé à un certain âge, s'intéresse peut-être moins aujourd'hui aux flingues qui pétaradent et aux braquages manqués, et un peu plus à ce que l'on sait de la vie après quarante-cinq ans. Tout ce que l'on a vécu. Tous ces souvenirs, ce deuil, ces expériences qui nous ont forgé. Comment, enfin, on cesse d'être un gamin pour devenir un adulte. Armé d'une double narration qui prend ces protagonistes dans leur jus, au moment des faits, avant de les redécouvrir plus tard, écornés, fatigués, ou peut-être plus entiers face au passage du temps... L'album a quelque chose de fondamentalement existentialiste (et vous pardonnerez l'emploi de cet adjectif, encore une fois, mais il est difficile de ne pas dégainer le cliché cette fois encore).
Mais alors, si on a bien l'impression d'un auteur mature, qui murit son expérience du polar en allant en plus emprunter à ses propres souvenirs pour dresser une histoire avec un propos, touchant et utile... quel est le problème ? Et bien, c'est tout bête, et vous allez rire, mais le problème tient en un mot : le dosage. Comme cela a déjà été dit, Reckless était capable de produire un grand écart récompensant pour le lecteur moyen de la bibliographie Brubaker - celui qui entre pour la violence, et qui sort avec l'impression d'avoir déjà trop vécu pour ne pas retrouver autre chose dans ces pages riches en contemplation sur le quotidien et l'expérience. Where the Body Was refuse de doser équitablement. L'intrigue criminelle se transforme vite en un... prétexte. Assouvie sans moment fort, sans montée en tension, sans pression, presque comme une scène comique, rapide, maladroite, désordonnée. Lui vous répondrait certainement que c'était justement l'objectif recherché. Mettre le lecteur avide de sensations fortes face à... cette déception, de croire qu'un polar construit et engageant termine finalement en un simple fait divers sans importance. Que la vraie vie n'est pas un chapitre de Criminal. Que parfois, c'est comme ça, que certaines choses qui marquent la vie se résument à des anecdotes de bar que l'on raconte aux copains, à soixante ans, sans même réaliser que tout ceci n'avait au final pas une si grande importance.
Mais l'ennui, c'est que cette écriture est peut-être encore un peu trop neuve dans la bibliographie de Brubaker. Au final, on ne croit pas à cette résolution, parce que celle-ci arrive trop tard. Parce que l'auteur prend trop de temps à installer ses profils, et trop peu de temps à terminer son histoire correctement. L'album s'ouvre avec une liste des différents personnages, comme les films de gangster. Comme si Brubaker n'arrivait pas encore à quitter ses codes, ses habitudes, au point d'induire en erreur le lecteur sur la direction donnée au projet. On assiste calmement à une installation programmée, lente, agréable... comme si l'album attendait perpétuellement de démarrer, et s'achevait au moment précis où il devenait intéressant. Avec trop peu de pages pour s'intéresser à ces personnages, qui deviennent, au final, extrêmement clichés. Aucun profil ne prend le pas sur les autres, on a même l'impression que le scénariste se répète à deux trois endroits. La seule nouveauté de Where the Body Was passe dans l'utilisation de scènes de sexe, là où l'auteur se montre généralement économe sur ce sujet.
Au final, le format roman graphique à moins de deux cent pages n'était pas le bon choix pour un album qui veut parler du quotidien, et produire une montée en tension avant de la désamorcer. Le lecteur aura à peine le temps de connaître les héros et de voir tout ce petit jeu de fausse piste s'installer... que l'histoire sera déjà terminée. L'ouvrage se referme avec l'impression d'un titre qui passe un peu à côté de son sujet, et gagne surtout en intérêt pour les lecteurs fidèles, qui pourront rattacher les wagons avec le reste de cette bibliographie. Dans l'évolution du propos, du rapport entre réalité et fiction. Pour les autres, malheureusement, Where the Body Was a surtout une bonne tête de caprice personnel, vaguement excluant, et où, peut-être pour la première fois de sa carrière, Brubaker n'est plus maître de son propre rythme.
Un constat amer, mais qui se comprend dans un ensemble plus général. Peut-être justement que l'auteur commence à arriver au bout d'une logique, et que Where the Body Was annonce la venue d'une nouvelle période. Peut-être que le scénariste vedette a besoin d'autre chose. Que tout ce rapport à ses auteurs préférés, aux romans policiers, au cinéma des détectives, aux espions ou à l'histoire des Etats-Unis, que tous ces éléments qui forment sa base thématique ont été suffisamment étudiés pour lui permettre de passer lentement à des thèmes plus personnels. Alors, ici, comme d'habitude, il nous parle d'un mort... alors qu'il aimerait de nous parler de la vie. L'intention est bonne, le projet éditorial intelligemment manœuvré, mais après avoir suivi à la lettre cette consigne du roman graphique, Ed Brubaker et Sean Phillips doivent aussi accepter que pour appréhender une nouvelle période, de nouvelles envies, il faut aussi accepter d'aller vers de nouveaux formats. En l'occurrence, il manque à cet album une cinquantaine de pages pour créer cette impression de quotidien, de cette petite vie, d'un groupe d'anonymes dans le même quartier, ou d'un réel sentiment d'épilogue, pour réussir à transcender l'exercice. C'est dommage. Mais même les grandes bibliographies ont leurs œuvres mineures.