
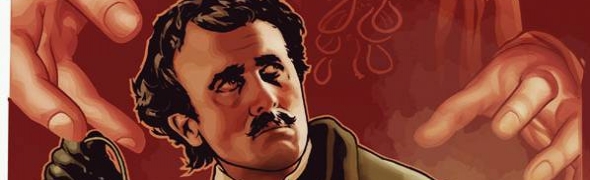
Bienvenue dans la nouvelle édition de The Wanderer’s Treasures. Au programme cette semaine des meurtres, quelques pièces d’argent, un corbeau, un puit et un pendule, la mort rouge démasquée et même des golems. Tout ça dans Poe par J. Barton Mitchell (dont c’est le seul travail) et Dean Kotz (Black Coat, Charmed), mini-série publiée en 2010 par Boom ! Studios.
 Poe c’est une histoire
fantastique, qui commence comme un polar et bascule doucement vers l’horreur.
Quoi de plus logique vu son héros ? Car c’est bien l’écrivain Edgar Allan Poe qui est la vedette de
ce récit, ainsi que son frère William.
J. Barton Mitchell mêle donc allègrement fiction et réalité, utilisant des
personnages et un évènement réels (la mort de la femme d’Edgar Poe, Virginia), et prenant aussi bon nombre
de liberté que ce soit pour son scénario, totalement inventé ou même pour des
détails (William Poe fut marin, écrivain, mais jamais policier). Et le résultat
est on ne peut plus convaincant.
Poe c’est une histoire
fantastique, qui commence comme un polar et bascule doucement vers l’horreur.
Quoi de plus logique vu son héros ? Car c’est bien l’écrivain Edgar Allan Poe qui est la vedette de
ce récit, ainsi que son frère William.
J. Barton Mitchell mêle donc allègrement fiction et réalité, utilisant des
personnages et un évènement réels (la mort de la femme d’Edgar Poe, Virginia), et prenant aussi bon nombre
de liberté que ce soit pour son scénario, totalement inventé ou même pour des
détails (William Poe fut marin, écrivain, mais jamais policier). Et le résultat
est on ne peut plus convaincant.
Tout commence sur la tombe de Virginia Poe où un Edgar hagard vient se recueillir. Traumatisé par la mort de sa bien aimée (emportée par la maladie), l’écrivain n’arrive même plus à écrire une ligne. Et en plus d’avoir perdu toute inspiration, il est accablé par des visions morbides, comme celle de la fillette qui s’est pendue dans la chambre qu’il occupe à la clinique où on essaie de le soigner. La plus insistante de ces visions est… un corbeau (on va y revenir). A force de perturber le fonctionnement de la clinique par son comportement erratique, Edgar va s’en faire chasser. Son frère William, un policier donc, va venir le chercher mais le devoir va l’appeler aussitôt. Edgar et lui se rendent donc sur une scène de crime (non, pas rue morgue). Et là l’écrivain traumatisé va faire preuve d’un esprit de déduction « sherlockholmesque », ou peut être plus exactement « dupinesque ». Ses analyses mêlant froide rationalité, superstitions et acceptation comme un fait de l’existence du surnaturel, en déconcerteront plus d’un autour de lui. Et raviront le lecteur amateur d’armchair detectives à la Poirot ou Holmes.
Pensant que d’enquêter l’aidera à oublier la défunte Virginia, Edgar s’associe donc à l’enquête de son frère William. Enquête qui le amènera à s’opposer à Roderick Usher (tiens, tiens,…), un autre homme anéanti par la perte de l’être aimé. Il nourrit en effet le projet insensé de redonner vie à sa sœur. Pour cela il a besoin de cinq augustus denarius. Les denarius étaient des pièces de monnaie romaines, et trente d’entre elles auraient servi à payer le traître le plus célèbre de tous les temps. L’enquête des frères Poe sera riche en rebondissement mais aussi en action, la présence d’éléments surnaturels (des golems par exemple) n’étant pas qu’un fantasme d’Edgar. Le tout donnant un résultat extrêmement plaisant.
 L’autre élément qui rend le récit
de J. Mitchell Barton plaisant, c’est le traitement du personnage d’Edgar. Pour
cet être blessé, détruit, cette enquête c’est le salut. Et la pire des
tentations (repensez aux motivations de Roderick Usher). Le scénariste arrive à
rendre son héros très touchant et attachant, mais aussi charismatique par son
côté gentiment excentrique et son esprit vif. Et les personnages secondaires
comme William et son épouse Elaine,
ou Roderick, le vilain, sont aussi bien écrits.
L’autre élément qui rend le récit
de J. Mitchell Barton plaisant, c’est le traitement du personnage d’Edgar. Pour
cet être blessé, détruit, cette enquête c’est le salut. Et la pire des
tentations (repensez aux motivations de Roderick Usher). Le scénariste arrive à
rendre son héros très touchant et attachant, mais aussi charismatique par son
côté gentiment excentrique et son esprit vif. Et les personnages secondaires
comme William et son épouse Elaine,
ou Roderick, le vilain, sont aussi bien écrits.
Mais ce qui rend cette mini-série exceptionnelle et en fait plus qu’un sympathique polar surnaturel, c’est la manière qu’a Mitchell d’émailler son récit de mille et un détails et anecdotes. Il y a les multiples superstitions d’Edgar en premier lieu. Elles vont des plus connues (ne pas marcher sous une échelle, fermer les yeux des morts…) aux plus obscures (retourner les objets en argent qu’on a dans sa poche si on a vu une demi lune à travers du verre, attacher une pierre à une clé pour se protéger des enchantements…). Cette multitude de détails ajoute un côté pittoresque à l’histoire. Il y a aussi l’utilisation de légendes comme celle du golem (avec des variations et détails intéressants), ou des denarius. Mais le meilleur, c’est sûrement l’incorporation de nombreuses références à l’œuvre littéraire d’Edgar Allan Poe, qui ravira ses adeptes.
Il y a d’abord le fait de faire d’Edgar un détective, clin d’œil au fait que l’auteur est considéré par beaucoup comme l’inventeur du polar avec « Les Meurtres De La Rue Morgue » (la nouvelle, et Auguste Dupin son héros, sont d’ailleurs mentionnés). Il y aussi les extraits du poème « Annabel Lee » pour exprimer le chagrin d’Edgar. On regrettera au passage que Mitchell n’ait pas réussi à intégrer d’extrait de « The Conqueror Worm », dont le thème (le triomphe sur la mort) aurait été approprié vu l’intrigue. Et puis il y a tous ces clins d’oeils, plus ou moins appuyés comme autant d’œufs de pâques. Le nom d’Usher et sa maison (« La Chute De La Maison Usher »), le costume du vilain (« Le Masque De La Mort Rouge »), le fait qu’Edgar se saoule à l’amontillado (« La Barrique D’Amontillado »). A la fin c’est toute la nouvelle « Le Puit Et Le Pendule » qui est rejouée, jusqu’à la façon dont le prisonnier s’en sort. Et il y a ce sinistre corbeau, tout droit sorti du poème du même nom (encore une fois quel dommage que le scénariste ne nous case pas un petit « nevermore »). On aperçoit même une momie avec laquelle on voudrait avoir une conversation.
 En fait la seule chose qui
surprend c’est l’utilisation des denarius
et des golems. Pour les pièces romaines, finalement on s’y fait, vu que la mini
ne veut pas être une adaptation d’une œuvre de Poe, rajouter cet élément
fantastique ne choque pas. Mais pourquoi utiliser des golems, alors qu’on n’en
trouve pas trace dans l’œuvre de l’auteur ? Le seul rapport qu’on peut établir entre Poe
et ce mythe juif, c’est grâce à « The
Golems Of Gotham » par Thane
Rosenbaum, où une adolescente crée un golem à New York. Et la jeune fille habite sur Edgar Allan Poe Street (une portion de la 84ème rue
Ouest entre West End Avenue et Broadway). Mais c’est franchement capillo-tracté
et l’explication la plus plausible est que Mitchell avait besoin d’un gros bras
pour assister son vilain, alors il a choisi un monstre au background qui lui
plaisait. Et ça ne nuit pas à l’histoire. On pourra juste trouver dommage qu’il
n’ait pas puisé dans le bestiaire de Poe (le singe coupable des meurtres de la
rue morgue aurait aussi bien pu être utilisé). Mais ce petit bémol ne doit pas
vous empêcher d’apprécier ce qui est une excellente mini-série.
En fait la seule chose qui
surprend c’est l’utilisation des denarius
et des golems. Pour les pièces romaines, finalement on s’y fait, vu que la mini
ne veut pas être une adaptation d’une œuvre de Poe, rajouter cet élément
fantastique ne choque pas. Mais pourquoi utiliser des golems, alors qu’on n’en
trouve pas trace dans l’œuvre de l’auteur ? Le seul rapport qu’on peut établir entre Poe
et ce mythe juif, c’est grâce à « The
Golems Of Gotham » par Thane
Rosenbaum, où une adolescente crée un golem à New York. Et la jeune fille habite sur Edgar Allan Poe Street (une portion de la 84ème rue
Ouest entre West End Avenue et Broadway). Mais c’est franchement capillo-tracté
et l’explication la plus plausible est que Mitchell avait besoin d’un gros bras
pour assister son vilain, alors il a choisi un monstre au background qui lui
plaisait. Et ça ne nuit pas à l’histoire. On pourra juste trouver dommage qu’il
n’ait pas puisé dans le bestiaire de Poe (le singe coupable des meurtres de la
rue morgue aurait aussi bien pu être utilisé). Mais ce petit bémol ne doit pas
vous empêcher d’apprécier ce qui est une excellente mini-série.
Au niveau du dessin, le nouveau venu Dean Kotz opte pour un style très vintage, assez proche des gravures du XIXème siècle, et ça fonctionne parfaitement pour l’histoire. En cela il se rapproche de Francesco Francavilla sur ses premiers travaux (il avait d’ailleurs succédé à Francavilla sur le très bon et très inconnu « Black Coat : … Or Give Me Death »). Il y a aussi un peu de Michael W. Kaluta (Madame Xanadu) au niveau des influences. Le visage de Poe est réussi et on reconnaît bien l’auteur. Les mises en pages sont étonnamment dynamiques, et le tout reste très lisible malgré un format plus petit que les comics classiques, un bel effort. Les couleurs sont sombres à souhait, ce qui est parfait vu l’histoire et leur grain particulier ajoute au côté « vieux » de l’ensemble, pour un résultat irréprochable. Seuls quelques cadrages pourront ça et là laisser à désirer, mais c’est du détail. Enfin les décors sont fouillés et magnifiques, participant à l’immersion, de même que les designs des personnages et créatures.
Poe est donc tout d’abord un très bon polar surnaturel avec un personnage principal très attachant et une intrigue accrocheuse. Mais c’est surtout une gourmandise pour les adeptes des écrits d’Edgar Allan Poe, qui se régaleront de voir les créations de l’auteur utilisées et réinterprétées avec talent. Et les ajouts, s’ils peuvent surprendre, n’enlèvent rien au plaisir de lecture. Le récit est servi par des dessins qui ne sont certes pas les plus sexy du monde, mais correspondent parfaitement au ton de l’œuvre. Il ne me reste donc plus qu’à vous souhaiter bonne lecture, peut-être avec un verre d’amontillado. Et tâchez d’ignorer ce corbeau à la fenêtre…
