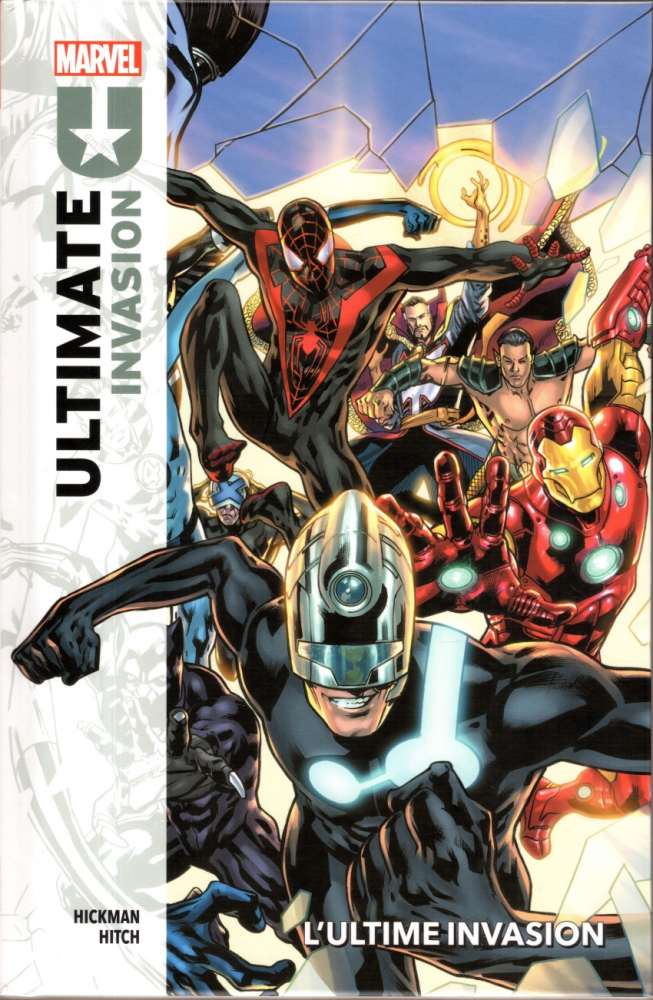Bienvenue dans une nouvelle édition du Cahier Critique VF. Cette chronique est à lire en parallèle de nos Critiques Express VO, et comme son nom l'indique, son but est de vous proposer à intervalles réguliers des avis sur des sorties VF plus ou moins récentes. Notre vocation est de montrer l'incroyable diversité des genres dans la bande dessinée américaine, en mettant autant que possible en avant ce qui nous paraître être bon, qu'il s'agisse de super-héros ou de comics indépendant.
Nous nous autorisons à aussi à faire figurer dans le Cahier Critique de la bande dessinée de genre venue de France ou d'Europe, dont nous pensons qu'elle pourra certainement plaire à celles et ceux qui parcourent nos colonnes. Bonne lecture !
En BD, on peut tout faire. C’est en tout cas comme ça que les artistes de comics aiment présenter la distinction entre leur discipline et d’autres formes d’art, plus coûteuses, ou plus bornées aux normes du réalisme apparent. Et c’est vrai. Sauf que, si l’on prend un peu de distance, cela peut aussi signifier que le scénario et le dessin vont tenter de repousser les limites… dans des directions opposées. Un bel exemple se présente pour vérifier cette théorie avec le comics Mindset de Zack Kaplan et John Pearson. D’un côté, un auteur spécialisé dans la science-fiction, qui veut pousser le potard de la fiction à la Black Mirror, et de l’autre, un autre fils caché de Bill Sienkiewicz qui compte sur ce rapport au virtuel pour mener toute une série d’expériences avec le dessin, l’esthétique, la mise en scène des couleurs et des formes. Côte à côte, ces deux aspirations se matérialisent sous la forme d’un comics à la fois fascinant et déséquilibré. Une plongée dans l’angoisse d’un monde perpétuellement connecté, saisissante et psychédélique, en surimpression d’une intrigue qui remixe le propos de Social Network sous l’angle d’un conte moral à la Creepshow. La sauce prend, mais la saveur interroge.
Côté scénario, Mindset va donc s’intéresser à un petit groupe d’étudiants en informatique. Leur objectif est tout bête : désengager les mécanismes de contrôle orchestré par les applications, les publicités, la quête perpétuelle du temps de cerveau disponible, pour aider l’être humain à naviguer le monde virtuel sans être systématiquement poussé à consommer ou réfléchir selon telle ou telle variable algorithmique. Kaplan appuie son propos sur l’idée de “l’influence.” Un mot que l’on va sans cesse croiser au fil de cet album. Nous serions, utilisateurs, consommateurs, sous l’influence de quelque chose ou de quelqu’un. Qu’il s’agisse de la société, qui nous incite à suivre un mode de vie préprogrammé (les études, le boulot, le mariage, les enfants), du capitalisme qui nous pousse à rechercher le succès et la validation (l’argent, les voitures, les objets), ou de l’individualisme qui nous pousse à vouloir la reconnaissance des autres par le prisme trompeur des réseaux (les favs, le nombre d’abonnés, etc). Ce propos s’agglomère dans une accumulation d’exemples assez confus - le scénariste met dans le même sac toute une batterie d’idées et de principes lointains, pour ratisser le plus large possible. En résumé, Zack Kaplan estime que l’être humain moderne et connecté n’est jamais complètement libre. Et l’album va construire une allégorie extrêmement générale sur le sujet sans chercher à s’encombrer des détails.
Le héros de l’aventure a une solution à tout ça. En découvrant une technologie qui permet (au sens propre) de prendre le contrôle de l’esprit de quelqu’un, il va développer une nouvelle application, dans le but de… permettre aux gens de se libérer du contrôle des marques, des réseaux, de l’influence. Une fois cette application lancée, Mindset suit le parcours classique des oeuvres qui étudient de près les mécanismes de la Sillicon Valley : le héros va lancer sa boîte avec ses potes, goûter au succès, s’engueuler avec les partenaires fondateurs, et perdre rapidement le contrôle de sa propre création. Là-dessus, Kaplan est un peu plus précis. On comprend vite que l’appli’ Mindset est une tacle directe à Facebook, Twitter, Instagram, au sujet du contrôle des données personnelles, de l’addiction aux réseaux sociaux, de la place de la technologie dans la société moderne. Et aussi, des nouveaux milliardaires. De ces adulescents qui deviennent riches trop vite avec le produit miracle, au point de faire valdinguer tout principe de moralité. Et comme cette partie du propos reste bien fichue, bien grattée, on arrive à s’arranger avec le reste du scénario pour trouver des paraboles personnelles qui fonctionnent : en gros, Kaplan a l’intelligence de viser large sur l’idée du monde virtuel, et de viser précis quand il s’agit de nommer les responsables.
Le scénario remplit son rôle de Social Network version Black Mirror. Arrivé au milieu de l’album, on se laisse prendre au jeu, en lâchant un regard circonspect à son propre téléphone, posé sur le canapé, comme le sursaut d’un cerveau qui réalise que : oui, il va bien falloir se reconnecter à un moment ou un autre. Que cette fenêtre noire qui sommeille n’est pas une porte chaleureuse vers les blagues de copains, les photos de famille et les tuto’ bricolage. Que cette virtualité a été orchestrée par quelqu’un qui veut, au fond, vous vendre quelque chose. Savoir ce que vous faites, où vous le faites et pourquoi. Et que cette idée du contrôle mental, poussée à fond dans l’album (dans la mesure où Mindset pousse ses utilisateurs à se loguer à intervalles réguliers), prise sous l’angle de l’horreur, pousse à s’interroger sur l’état actuel de nos propres dépendances. En fond, le titre passerait presque pour une série d’épouvante sociale, si le trait n’était pas aussi épais par endroits.
Seulement, voilà : la conclusion accumule les retournements de situation jusqu’à la nausée, et on comprend assez vite que le scénariste n’avait pas exactement prévu une fin solide avant de se lancer dans l’écriture. Ou pas de conclusion qui se rapporte vraiment au propos même de l’album. L’intrigue chercherait à nous expliquer que c’est trop tard, que le “monstre internet” est devenu autonome… mais Kaplan peine à retomber sur ses pattes. Est-ce que c’est grave ? Pas forcément, dans la mesure où l’écriture ne représente qu’une moitié de l’expérience du titre.
Côté dessins, John Pearson va beaucoup plus loin. La possibilité de s’amuser avec cette “horreur virtuelle” correspond exactement au coup de crayon de ce dessinateur, adversaire du réalisme, amoureux des effets. Dans des pages chargées en nuances de vert et de violet, l’artiste multiplie les expériences et les décalages, pour construire des planches perpétuellement baignées dans cette impression de labyrinthe brumeux, froid, solitaire, comme si les personnages étaient déjà paumés dans le flux du contrôle mental. Le travail sur les cases et les polices d’écriture participe à construire cette atmosphère de cauchemar, comme si chaque dialogue était couvert par le bruit de la machine. Parfois, l’artiste va aussi découper ses personnages hors des cases. A d’autres moment, l’héroïne de l’album surgit, pour marquer une différence par sa présence, sa garde robe. Avec les décors, les découpages, le simple effet de “buzz” induit par l’application Mindset, Pearson déploie un arsenal complet de graphiste accompli qui a réfléchi au moindre détail pour bâtir l’armature de cet univers, à la fois détaillé dans ses couleurs et ses encrages et dépouillés dans ses décors et ses éléments de “réel.” Une magnifique expérience, et qui évoque forcément le travail des autres fils cachés de McKean et Sienkiewicz, Anand RK et Martin Simmonds, comme pour signifier le retour graduel du dessin de comics abstrait et expérimental sur le devant de la scène, avec des oeuvres aussi formidables que Blue in Green, Department of Truth, ou dans le mainstream, le superbe Joker : Year One de Stevan Subic qui s’amusait déjà à poser une surcouche de subjectivité cauchemardesque et inextricable sur la façade de Gotham City.
Alors, bien sûr, par endroits, on aurait presque l’impression que l’artiste a mieux réfléchi son projet que le scénariste. Et c’est peut-être le cas : si Zack Kaplan est un scénariste intelligent et doué, le titre Mindset passe pour une nouvelle variation dans la bibliographie d’un auteur productif, et qui s’amuse à éplucher la science-fiction sous tous les angles possibles. De son côté, Pearson a encore des choses à dire et à prouver, et a sans doute dû envisager le titre comme une carte de visite, dans la mesure où celui-ci reste encore assez neuf sur les séries complètes, en planches intérieures. Mais, dans un méli mélo assez amusant, le résultat fonctionne par effet d’addition. Un comics avec des choses à dire, monté sur un scénario conventionnel, mais tout de même bien fichu, et sur une esthétique unique, qui va transcender le fond au profit de la forme. Cette équation permet à Mindset de ne pas tomber dans le piège de la “BD Black Mirror”, par la magie naturelle du format comics, qui peut davantage se permettre, ou se reposer sur l’effort de l’un quand l’autre préfère aller à l’essentiel.
Corentin
- Vous pouvez commander Mindset à ce lien !
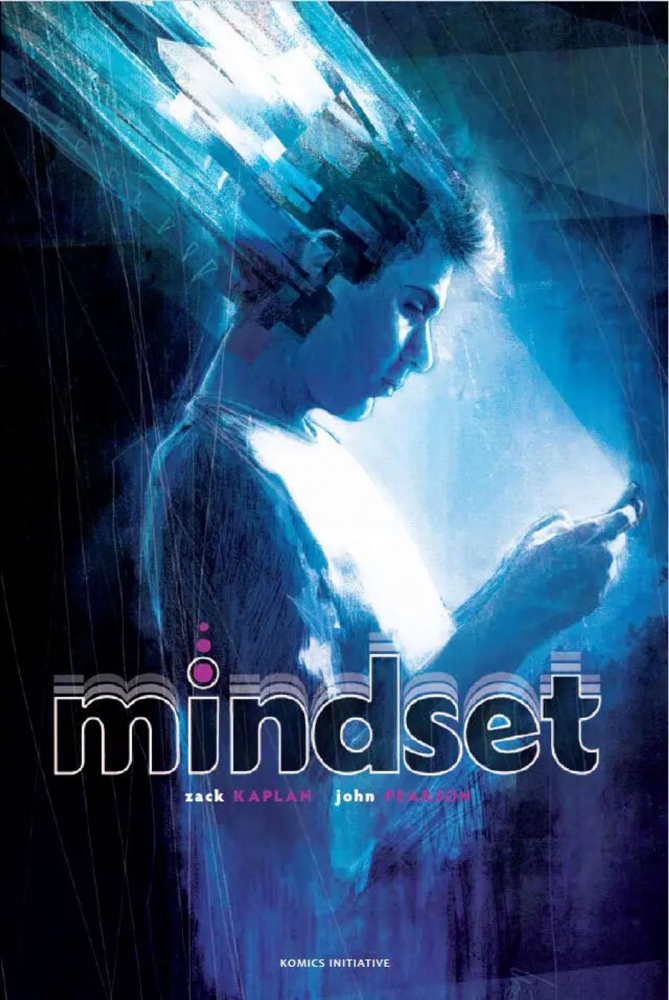
On l'a écrit et répété plusieurs fois dans ces colonnes. Si le label Glénat Comics n'existe plus en tant que tel, ce n'est pas pour autant que les bandes dessinées américaines ont cessé de venir garnir les différentes collections de la maison d'édition française, sous l'impulsion de Nicolas Forsans. Récemment, on avait notamment pu découvrir avec plaisir chez Glénat l'excellent Friday d'Ed Brubaker et Marcos Martin, catégorisé en "jeunesse" quoique la tonalité du récit peut porter cette appellation à débat. Dans le cas de La Voie Dragon, il n'y aura pas débat. Le récit d'Ethan Young (Life Between Panels) s'inscrit dans le récit d'aventure pour adolescent(e)s, dans un registre tous publics qui convoque des thématiques visiblement chères à l'auteur.
Le clan Wong, un peuple nomade, cherche à rejoindre le Vieux Pays pour pouvoir s'y installer, mais doit passer ce faisant sur le territoire de leurs ennemis jurés, la tribu du Dragon. Très vite, le cortège est attaqué et le jeune prince Sing arrive à échapper à ses assaillants. Il tombe alors sur un vieux sage mystique répondant au nom de Ming ainsi que d'une créature qui l'accompagne, un chat géant à corne, dénommé Minuit. Ensemble, ils vont essayer de sauver la tribu Wong, dont les problèmes viennent autant de leurs assaillants extérieurs que de leurs failles internes. Le récit d'Ethan Young se dévore littéralement grâce à une aventure sans réel temps mort, où même les moments de calme se montrent en réalité assez vifs. Sing est un jeune garçon tout à fait attachant et le fait de lui administrer un gros chat comme compagnon donne forcément un capital sympathie immédiat à ce duo. Young ne cherche pas à réinventer la roue du récit initiatique et l'apprentissage de Sing suit quelques passages obligatoires, sans pour autant que le lecteur ait l'impression d'être dans le cliché ou le déjà-vu.
Ce qui intéressera certainement les lecteurs plus adultes (qui s'intéressent à la bande dessinée pour ado', ou qui iront piquer le bouquin à leurs proches/enfants), ce sont les thématiques sous-jacentes à l'histoire principale, que l'on peut apprécier au premier degré. Il y a un jeune héros qui a tout à apprendre, des compagnons qui sont là pour l'aider à accomplir son objectif, des adversaires à la hauteur des enjeux, les touches de folklore chinois étant appréciables (le peuple dragon, en l'occurrence, ou la gigantesque orbe qui fait office de mcguffin, sont réussis). Mais au-delà de ces aspects, La Voie Dragon nous parle aussi de déracinement des peuples, d'héritage, de l'importance que l'on attache à sa famille. Sing est partagé entre ce qu'il pense être son devoir, mais va aussi revoir ses préjugés par rapport à ce qu'il croît connaître de l'histoire de son peuple. Le cheminement psychologique montré est assez intéressant, avec une résolution de l'intrigue qui sort des sentiers battus.
Par ailleurs, Ethan Young se montre aussi de bonne facture sur la partie graphique. On y retrouve un trait à l'encrage assez épais pour les personnages, et un pointillé détaillé pour les décors afin de leur donner du relief, pour un ensemble assez réussi, qui évoque - évidemment - la bande dessinée asiatique autant que l'animation. Le cortège avec ses maisons sur roues convoque tout un tas d'imaginaires différents, de Mortal Engines au Château Ambulant, qui est un petit plaisir pour les yeux. Comme évoqué précédemment, d'autres touches de fantastique participent à la générosité visuelle de cet univers, et le découpage de Young, adapté à la BD jeunesse en faisant des planches en 3-4 cases, se montre agréable dans sa simplicité. L'artiste n'en oublie pas qu'il travaille pour le marché américain avec quelques double-pages où l'on sent qu'il se fait plaisir, puisque certains passages nécessitent d'avoir plus d'espace utilisé. Ne serait-ce par exemple que pour des questions d'échelle de grandeur.
La Voie Dragon est donc une lecture agréable en tant que tel. Si l'on a pu écrire sur des titres jeunesse qui, par leur thématiques ou leur écriture, se destinaient complètement à un lectorat adulte, mettons que l'album d'Ethan Young a moins de niveaux de lectures que d'autres. Le voyage initiatique du prince Sing se montre assez classique, mais les thématiques qui l'entourent, ainsi que la conclusion, aident à faire de cette histoire quelque chose de plus original qu'aux premiers abords. Surtout, l'ensemble est très plaisant visuellement, et peut constituer un chouette cadeau à vos proches, si la BD adolescente ne vous par le plus trop.
Arno Kikoo
- Vous pouvez commander La Voie Dragon à ce lien !

Entre deux séries de super-héros, Joshua Williamson s’amuse à inventer. Sur le marché indépendant, le scénariste lâche régulièrement de nouvelles créations originales, où l’objectif n’est pas systématiquement de détruire la Terre ou de réécrire la continuité globale. Et c’est curieux, mais le résultat est généralement meilleur que ce que le loustic produit chez DC Comics. En compagnie de son vieux copain Andrei Bressan, Williamson a donc décidé de reformer l’équipe créative de Birthright pour un comics d’horreur… ou mettons, d’horreur légère. Le titre en question s’appelle Dark Ride, et trouve ses racines dans un folklore particulier. L’histoire se situe en effet dans l’environnement préféré des enfants, où rien n’est vrai mais où tout est magique et merveilleux (ainsi que : cher, blindé de monde, et souvent en travaux) : un parc d’attraction. Et en l’occurrence, un parc d'attractions essentiellement constitué de maisons hantées et de trains fantômes, le bien nommé Devil Land.
En s’inspirant grosso modo de l’histoire de Walt Disney et de la fondation du parc Disneyland, Williamson va s’amuser à poser les fondations d’un authentique terrain de jeu que le lecteur va se plaire à visiter, chapitre après chapitre. Grands huit inspirés par le cinéma d’horreur classique, mascottes démoniaques, secrets enterrés ici ou là, la série Dark Ride exploite à fond l’imagerie de ces hauts lieux du divertissement familial. Le Devil Land a sa propre histoire, associée à la famille de son fondateur. Et le comics obéit à une feuille de route balisée : on prend le lecteur par la main en présentant un premier personnage, qui passe d’abord pour le héros… avant de bifurquer vers une saga familiale plus complexe, tortueuse. Le fondateur du parc se planque à l’abri des regards, son fils, un businessman raté, tente de gérer les affaires courantes… et la soeur, devenue une starlette du cinéma et de la chanson entre deux prises de drogue dure, rentre à la maison. Un paysage somme toute très complet, qui cadre avec les codes des films d’horreur (aux portes de la comédie) des années quatre-vingt, à la Joe Dante, dans un prisme inquiétant et académique qui évoquerait la structure de certains romans de Stephen King. Les Etats-Unis du passé, le drame familial originel, le père fou, les deux enfants qui s’entredéchirent, un environnement ludique et peuplé d’opportunités. Sans oublier une science du cliffhanger qui parvient à équilibrer une histoire pensée pour le long terme en agençant toute une série de retournements réguliers.
Le personnage principal passe rapidement pour l’avatar du père de famille raté de cette même école de fiction, paumé entre des machinations qui le dépassent. Et bien sûr, le comics est rempli de références à la véritable mythologie des parcs d’attraction : cette curiosité du public pour les manèges, les passages secrets semés en cours de construction, les anecdotes, les trains qui déraillent. Ou simplement, cette question qui a pu hanter tout un tas de gosses au sortir de leur premier passage dans une maison hantée : est-ce que les monstres sont vivants et se baladent librement à la nuit tombée. Andrei Bressan offre un superbe travail pour associer le fond à la forme. L’esthétique globale de la série va dans cet esprit d’horreur “traditionnelle”, façon Contes de la Crypte. Dark Ride ne mise pas sur la générosité de l’épouvante par créatures : les monstres sont volontairement génériques, économes dans les formes et les aspects, parce qu’il est important de rappeler que le parc reste destiné à un grand public. En somme, le design évoque plutôt un imaginaire dans le style de La Famille Addams en plus coloré, aux couvertures de Chair de Poule ou plus simplement, au rayon déguisement d’un supermarché pendant les fêtes d’Halloween. C’est surtout la mise en scène qui participe à créer les quelques moments pensés pour faire peur. Où la mascotte du parc, d’une apparence somme toute simpliste, devient menaçante de par son sourire indélébile, d’autant plus glaçant qu’elle ne prononce jamais le moindre mot.
Dans cette enveloppe, qui aurait tendance à jouer sur l’idée d’une horreur “consumériste”, Williamson écrit toutefois une histoire pour adultes. Le personnage de Halloween est clairement présentée comme sexuellement active, les quelques gerbes de sang, lorsqu’elles surviennent, ne trichent pas, et le héros reste un modèle assez nuancé de père de famille incapable de rester à flot. Dans la liste des points noirs, on pourrait regretter le fait de voir l’histoire prendre son temps par endroits, pour accélérer brusquement, au point de se demander si le scénariste hésite entre une envie d’une saga plus longue que prévu, ou bien au contraire, s’il a encore suffisamment d’éléments à distiller pour permettre au comics de tenir dans la longueur. Rien de grave, en définitive. On se plaît à explorer le parc, dans la mesure où les oeuvres sur le sujet, comme WestWorld ou Jurassic Park, ont instauré cette tradition qui fonctionne encore aujourd’hui : le sujet même d’un lieu tout entier, coupé du monde et qui fonctionne comme une entreprise basée sur le plaisir exclusif du spectateur, reste fascinant. Et la curiosité de savoir ce qui se passe lorsque les portes se referment et que le client prend la route du parking peut nourrir toute une variété d’histoires possibles. Williamson et Bressan s’amusent (avec un plaisir palpable) à mettre des mots sur ce petit imaginaire.
Au global, de bons personnages, un bon sujet, une bonne idée. Dark Ride ne fait pas peur, mais ce n’est pas forcément l’objectif visé. Plus proche d’un comics familial à la Jeff Lemire, dans lequel on aurait arraché le traumatisme et le rapport obsessionnel à la fracture parentale, le titre se laisse découvrir avec enthousiasme, dans la mesure où tout a été suffisamment bien pensé pour rester neuf au bout du premier tome. A se demander s’il n’y aurait pas, d’ailleurs, matière à faire du Devil Land le sujet d’une anthologie consacrée aux expériences morbides des différents spectateurs du parc, dans la mesure où, lorsqu’on lit la BD, on se prend d’envie de visiter nous aussi les allées macabres de cette véritable petite carte postale dédiée à l’horreur américaine classique. Une bonne surprise, de la part d’un auteur qui gagnerait à passer plus de temps sur le marché indépendant et un peu moins dans sa collection de multivers colorés.
Corentin
- Vous pouvez commander Dark Ride Tome 1 à ce lien !

Si on prend suffisamment de distance avec le moindre genre de fiction, il devient vite facile de deviner les armatures. Les ficelles. Les grands principes fondateurs qui sous-tendent un même modèle, sur lequel les artistes vont ensuite pouvoir bâtir, à coups de variations, de variations, de variations. Et à cette distance, forcément, les objets qui sortent de cette mécanique ont tendance à se ressembler. C’est le principe. C’est même la définition du “genre” : dans un slasher, on s’attend à ce qu’une troupe d’adulescents se fasse mettre en pièces par un maniaque armé d’un outil de destruction X ou Y. Et alors, l’originalité, le récréatif, va passer par d’autres chemins que la simple exécution d’un script basé sur une formule qui laisse assez peu de place à la surprise. Et si l’on se base sur la situation du comics Arca de Van Jensen et Jesse Lonergan, le constat est peu ou prou équivalent.
A bord d’un vaisseau lancé à travers les étoiles, les derniers restes de l’espèce humaine attendent de pouvoir se poser sur leur nouvelle planète d’accueil. L’humanité s’est réfugiée à bord de cette “arche” de fortune pour construire, ailleurs, une nouvelle civilisation… dans la mesure où la Terre est évidemment devenue inhabitable. Bien entendu, le vaisseau en question a un long chemin à parcourir, et une micro-société s’est organisée entre ces murs pour organiser le travail, la hiérarchisation des tâches, l’ordre établi, etc. L’Arca a suivi la feuille de route classique des oeuvres de science-fiction : une élite intellectuelle gouverne le navire, et les prolétaires de l’équipage doivent obéissance et servitude à leurs maîtres vénérés. Alors. Voilà. En quelques mots, un scénario qui évoque la mécanique du huis clos, la logique d’une science-fiction qui ne parle pas tellement du futur mais plutôt du présent et du fonctionnement réel de nos sociétés. Pour expliquer que le genre humain sera toujours tenu en laisse par une caste de leaders auto-stipulée, qui entend maintenir ses privilèges, même une fois que la Terre aura été détruite. Et pour tenir lieu de motif général, de fil conducteur, une héroïne va mener l’enquête à bord du vaisseau pour comprendre comment toute cette mécanique a pu s’organiser (et la vérité sur les bienfaiteurs qui ont construit le vaisseau). Arca ressemble à Snowpiercer, à Silent Running, à Soleil Vert, à Dark City, ou pour prendre des référents dans l’art séquentiel, à Shangri-La ou à Far Sector.
Le comics trouve ses accents d’originalité dans l’idée d’une émancipation qui passe par la culture. Finalement plus proche de Farenheit 451 de ce point de vue, Arca part de l’idée que les travailleurs mis aux ordres, et qui estiment que leur condition répond à un ordre naturel précis, ont les moyens de s’émanciper par la culture. Par la découverte de l’art, de la littérature, en apprenant à lire… et au contact des histoires, à s’élever au-dessus de leurs certitudes en développant leur esprit critique et leur capacité au libre arbitre. Cette réflexion qui suit l’album passe par une série de moments agréables, qui prennent le temps d’installer des personnages, des paysages, et un environnement quotidien qui participent à rendre l’Arca tangible et à aider le scénario à construire une atmosphère avant d’aller vers les éléments “utiles”. Atmosphère qui cherche justement le contraste : une esthétique colorée, légère, douce, qui profite d’une économie dans le trait de Jesse Lonergan pour prodiguer un sentiment de petite fourmilière où il fait bon vivre… jusqu’au moment où le cynisme et la violence s’invitent peu à peu sur les planches, comme pour rappeler que cet agréable tableau est le produit d’un leurre. D’une tromperie organisée. Même si celle-ci est évidemment assez prévisible, on apprécie d’évoluer aux côtés de ces personnages dans cette gigantesque arche de Noé moelleuse et rassurante, finalement plus proche d’un coup de crayon à l’européenne, et qui ne cherche pas à donner dans la dystopie marquée ou dépressive. Un sentiment qui aurait tendance à évoquer l’excellente BD Frontier de Guillaume Singelin : un monde qui va mal, mais des personnages aux structures mignonnes, aux visages souriants, dans une palette chromatique en notes douces et en couleurs vives. L’exemple assez marquant du “champ” agricole construit à bord de l’Arca restitue avec adresse cette note d’intention : un ciel bleu, une apparence de lumière naturelle, un environnement qui rappelle les bons souvenirs de la Terre… mais si on regarde au plafond, on remarque les dalles, les éléments de construction. Comme des fissures dans cette apparence d’équilibre naturel et rassurant.
Le travail de Jesse Lonergan reste l’argument de vente principal de cet album. Prodige du découpage, celui-ci s’amuse à guider l’oeil du lecteur dans les scènes d’exposition… ou à chercher à le brusquer dans les scènes d’action, de chaos. Le dessinateur utilise avec adresse l’espace-planche pour incarner visuellement le fonctionnement même de ce vaisseau. De cette ruche bien organisée, à la mécanique bien huilée. Et à l’inverse, lorsque les murs de cette réalité se referment sur l’héroïne, les cases ont tendance à évoluer en conséquence. Par endroits, Lonergan s’amuse à rompre les gouttières, l’espace blanc qui sépare une case d’une autre. De petites entorses à cette organisation mécanique - comme par exemple, au moment où l’héroïne choisit un livre dans la bibliothèque. Son geste, qui traverse les cases au point de les rompre, est encore une fois à comprendre comme la matérialisation symbolique de cette émancipation graduelle. Une héroïne qui sort de sa case, de sa caste. On retrouve cet effet à d’autres endroits, souvent, pour signifier un sentiment inhabituel. Et si celui-ci n’est pas tout à fait nouveau, on apprécie de voir Lonergan se canaliser et mettre cet effort à contribution du scénario. Avec une modération élégante qui va à contre-courant de certains autres artistes modernes, qui cassent les codes du découpage classique par performance, pour la prouesse esthétique, sans forcément s’aligner sur l’intentionnel du scénario.
Tout ceci n’empêche pas Arca de tomber dans certains pièges. L’allégorie des 1%, d’accord, quelques surprises, oui, mais dans l’ensemble, le titre a surtout contre lui d’occuper un espace déjà largement peuplé et de ne pas chercher à vraiment bouger de son socle. Aussi, une lecture prévisible, mais une lecture agréable, portée par une atmosphère réussie et un dessinateur qui devrait logiquement compter d’ici les années à venir, pour son habileté à animer une histoire et son envie de s’amuser avec le format. Et en parlant de format, comme d’hab’, le commentaire est forcément implicite, mais on appréciera encore et toujours le soin fourni par les éditions 404. Qui cherchent, à chaque fois, à produire des albums avec une réelle identité, une réelle gueule unique, pour se démarquer dans les rayons. A lire (mais d’abord, Frontier et Shangri-La si vous avez le budget pour).
Corentin
- Vous pouvez commander Arca à ce lien !

Pour une génération de lectrices et de lecteurs, la saga Ultimate Comics représente un genre de première marche. Une porte d’entrée, sans effort, vers les comics de super-héros dans une période où les éditions Marvel avaient décidé de faciliter le travail aux curieuses et aux curieux. L’objectif était alors d’ancrer les Avengers, Spider-Man, les X-Men ou les Fantastic Four dans un terreau plus moderne, une tonalité plus ouvertement politique, parfois plus matérialiste ou plus cynique. Entre les mains de Brian Michael Bendis et Mark Millar, un nouvel univers tout entier, bâti à quatre mains (et quelques), pour retravailler la continuité en profondeur, bouger certains éléments, en réinterpréter certains autres. Si les séries Ultimate Comics ont évidemment permis à beaucoup de gens de se mettre à lire du super-héros, en profitant d’une approche perméable, et plus en accord avec les codes d’une certaine époque, beaucoup d’anciens lecteurs auront aussi pris le train en marche pour s’amuser à redécouvrir les éléments neufs, les réinterprétations, et la sensation d’une continuité plus compacte capable de fonctionner en l’espace de trois ou quatre séries par mois. Une expérience qui aura marqué pour de bon l’histoire des comics, et dont les secousses se ressentent encore jusque dans le présent.
Problème : à l’instar de nombreux grands recommencements, les séries Ultimate Comics ont fini par se congeler contre la sempiternelle problématique du temps qui passe. Les comics Marvel ont ce défaut qui finit par écoeurer même les plus combatifs - ils ne terminent jamais. Et l’éditeur, s’il a bien tenté à plusieurs reprises de mettre à mort cette continuité, qui perdait de l’adhérence à force d’empiler les nouveaux albums, a fini par trouver la formule magique en se tournant vers le talentueux Jonathan Hickman. L’exécuteur des réalités condamnées. En pliant 616 et 1610 lors de l’événement Secret Wars, le scénariste vedette avait enfin trouvé la solution à des années de litiges complexes au sein des bureaux de la Maison des Idées. Sacrifier l’univers Ultimate ? D’accord. Mais il fallait aussi conserver certains éléments pour les fans. Et en fin de compte, ce qui aurait dû passer pour l’extinction d’une continuité devenue embarrassante et chargée en mauvais souvenirs a finalement eu droit à son propre générique de fin, en exfiltrant les deux mascottes fondamentales Miles Morales et Reed Richards pour de nouvelles aventures… à définir. Si le Spider-Man 1610 n’a eu aucun mal à se réinsérer sur sa “Terre” d’accueil, le Maker, lui, a été mis au frigo pendant un certain temps. En imaginant que quelqu’un finirait par tomber sur la bonne idée qui permettrait au loustic à crâne long de réapparaître dans une perspective à sa mesure. Donny Cates s’est porté volontaire, et puis, quelques temps plus loin, Jonathan Hickman a profité de cette porte ouverte pour produire une histoire à laquelle personne ne s’attendait vraiment. C’est à dire ? Une suite. Et un reboot.
Voici donc qu’arrive l’album Ultimate Invasion chez Panini Comics. Jonathan Hickman, celui qui avait terminé l’ancienne saga, reprend les commandes. Bryan Hitch, qui avait ouvert la première série Ultimates, l’accompagne aux dessins. Une sélection symbolique pour un projet pensé comme un passage de flambeau, qui s’évertue à fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. En un sens, le titre passe autant pour le prolongement des comics Ultimate de Hickman et Esad Ribic, toujours basé sur le Maker, son obsession pour la mise à jour d’une espèce humaine débarrassée de toute forme de chaos et de ses improbabilités mathématiques, dans un monde où les super-héros qui lui barraient la route autrefois ne seraient plus une donnée à considérer. Reed Richards va donc poser bagage dans une réalité susceptible d’être remodelée depuis la base, en suivant un processus de laboratoire. Bouger certains éléments, éliminer les risques contraires, et assumer, enfin, d’avoir créé son propre monde parfait, à son image. Une société pas si différente de la nôtre, mais où l’organisation du pouvoir et des querelles entre factions ne répond pas à un impératif humain de destruction mutuelle, mais plutôt à un équilibre. Une façon pour Jonathan Hickman de poser un constat : si on élimine les gentils, alors on ne peut plus vraiment dire que les méchants ont pris le pouvoir. Puisque celles et ceux qui se retrouvent au pouvoir ne se bornent pas à la convention manichéenne des forces en présence, mais simplement, à une loi naturelle imposée par un dieu totalitaire et invincible. Le Maker a gagné, et les Avengers n’existent pas pour lui imposer une résistance dans cette version des faits. Bienvenue sur la Terre-6160.
Le scénario va globalement s’intéresser à Howard Stark, et présenter en l’espace de quelques numéros les tenants et aboutissants de cet énorme paragraphe d’introduction, dans une continuité encore en état de friche. L’objectif se résume en quelques mots : présenter cette nouvelle réalité, et expliquer contre quoi et contre qui vont devoir se battre les futurs justiciers du coin. En accord avec ses habitudes, et une obsession toute personnelle, Jonathan Hickman va mécaniquement opter pour un choc des cerveaux. La famille Stark d’un côté, le Reed Richards Ultimate de l’autre, un suivi somme toute assez logique pour l’auteur des différentes séries S.H.I.E.L.D. que beaucoup s’amusent à décrire comme l’intello’ des comics de super-héros. Rapidement, quelques premiers concepts se mettent en place, parfois en clins d’oeil directs à l’ancien univers Ultimate Comics. La mini-série commence à poser son exercice de variation, avec de premières différences notables, des personnages qui changent de camp, d’autres qui brillent évidemment par leur absence, et on rappelle d’entrée de jeu que le Maker n’est pas un super-vilain comme les autres. Impeccable, cruel, toujours aussi menaçant, cette version alternative de Reed Richards demeure probablement comme l’un des exemples les plus réussi des versions “négatives” de justiciers conventionnels. Le lecteur qui aura suivi toute la saga Ultimate se retrouve immédiatement récompensé en retrouvant cette ancienne clé de voûte d’un univers disparu, comme les lecteurs des New 52 avaient apprécié de retrouver Darkseid à l’aube du reboot de Geoff Johns en son temps. La fidélité aux personnages, ça paye, et Hickman mise ici sur le circuit de la récompense.
De son côté, Bryan Hitch s’applique également à retrouver le souffle, l’esthétique mécanique et industrielle des comics Ultimates d’autrefois. Le produit est un parfait résultat de sa propre consigne éditoriale, à la fois dans la familiarité qui se dégage de ces planches, de ces designs, en opérant comme une suite directe qui serait passée par-dessus Secret Wars et aurait pu être compilée dans un omnibus Ultimate comme si de rien n’était… tout en s’amusant également à créer, à noircir cette page blanche d’éléments neufs, en instillant ce sentiment d’un monde Marvel castré, brutalisé, laissé aux mains des affreux. L’histoire de Tony Stark, que l’on découvre ici au stade de l'adolescence, est un exemple assez complet de la philosophie du titre. On comprend rapidement que Tony va encore jouer le rôle de l’invincible Iron Man d’ici les prochains volumes - mais pour l’heure, ce n’est encore qu’un enfant. Celui qui campe le rôle-titre est, à l’inverse, un homme âgé. Une allégorie du renouvellement des générations, qui épouse l’idée même d’une transition entre deux sagas Ultimate, appuyée par des pages de titre (“à la Hickman”) qui reprennent le célèbre mantra “les bons artistes copient, les grands artistes volent”, en note d’intention. Le scénariste ne prétend pas réinventer la roue, ou s’improviser révolutionnaire en reprenant une équation déjà appliquée il y a plus de vingt ans. En revanche, il estime qu’il est encore capable de raconter de nouvelles histoires, dans ce même moule, cette même arborescence.
Au global, cette petite entrée en matière a même plutôt l’air d’un crossover estival que d’une simple introduction. Des créatures toutes puissantes se mettent sur la tronche, avec la force cosmique et l’exagération de routine des grands jours, et dans un circuit narratif qui vole rapidement vers sa conclusion, on n’est même pas forcément certain d’avoir tout compris dans l’alternance des temps (au sens propre) qui guide la main de Jonathan Hickman. Est-ce que Ultimate Invasion marque simplement la fin du Maker, la fin d’une certaine façon d’écrire et de comprendre les comics Ultimate ? Ou bien, au contraire, s’agit-il d’une Crisis qui ne dit pas son nom, et qui mérite forcément de commencer par un échange de mandales survoltées pour mériter sa place dans cette continuité à cheval sur deux versions du réel ? Une chose est sûre : pour celles et ceux qui ont apprécié le travail du bonhomme aux temps anciens où la Maison des Idées fonctionnait sur ce principe de double répartition du canon, le titre est une franche réussite. Un exercice de style qui tient debout, qui fait envie, et qui sait immédiatement canaliser tout ce qui a fonctionné autrefois. A l’escient d’une page vierge, d’une saga mise à jour, pleine de promesse, et commandée par un capitaine sorti champion de la période Krakoa sur les X-Men, difficile de jouer les défaitistes ou de ne pas apprécier l’une des grandes forces de la lecture de comics : en retrouvant le Maker et le titrage “Ultimate”, on est immédiatement projeté en arrière dans le temps, vers les grand temps forts, vers les bons souvenirs, et vers cette impression rassurante que chez les super-héros, même les bonnes histoires ne finissent jamais.
Corentin
- Vous pouvez commander Ultimate Invasion à ce lien !